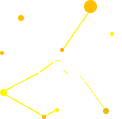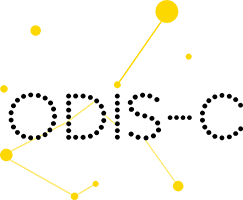Une reprise célèbre : « My way »: Paul Anka, en 68, reprend une chanson de Claude François, écrite en 67, après avoir rompu avec sa compagne et espéré reprendre: feront ils semblant, semblant de s’aimer « Comme d’habitude » ou s‘aimeront ils vraiment ? Chantée par Sinatra en 69, cette reprise diffuse quant à elle les paroles d’un homme mûr face à la finitude qui revoit les événements marquants de sa vie : il a peu de regrets, il a ri, pleuré, eu des bons et des mauvais moments, parfois gagné, parfois perdu, une chose est sûre, il a été lui-même et est toujours le même. Son style est inchangé. Il peut tout à la fois rire de ce qu’il a fait et rester digne. Une chose est sûre : il a tout fait à sa manière. Une même mélodie, des tonalités et des histoires qui différent. Une reprise c’est une chose qui reste la même, mais elle diffère : il y a dedans quelque chose de nouveau et qui peut dans le monde être repris par le soi à son propre compte. Si nous ne pouvons plus faire semblant comme avant, que souhaitons-nous ?
La reprise, c’est le titre d’un texte écrit par Kierkegaard alors qu’il se trouve dans la même situation que Cloclo. Lui, Soeren, il a rompu avec sa fiancée: Régine. Il voudrait bien reprendre, en un sens : faire la même chose, mais autrement, non pas reproduire leur échec, mais renouveler leur relation. La reprise est une « catégorie paradoxale » qui unit dans l’existence concrète ce qui a été, le « même », et ce qui est nouveau, l’« autre ». Sans doute faut-il se montrer capable d’introduire quelque chose de vraiment nouveau si l’on ne veut pas continuer à faire semblant d’être (un homme, une femme, un rôle, un type). Parce qu’elle présuppose une suspension du temps et la rupture préalable d’avec nos habitudes, notre vie sociale, professionnelle, économique, familiale, interpersonnelle, bref tout ce qui fait la circulation de notre humanité partagée et disséminée dans le monde, parce qu’elle questionne donc notre individualité, notre individualisme et la reprise à notre propre compte de la communauté dans un monde dont nous avons la certitude qu’il ne pourra plus désormais être le même, la crise du COVID n’est pas une simple crise sanitaire, c’est une crise existentielle.
Une crise existentielle à l’échelle du monde. Elle affecte globalement les états, l’état du monde, l’état de chacun, des communautés, du soi-même, l’espace et le temps à la fois interne et partagé dans lequel tous se déploient. Une crise paradoxale, complexe, qui tout à la fois nous fait parler et nous laisse muets, tant il est difficile d’être soi-même sans manifester son corps propre en touchant les autres et en étant touchés. C’est une pandémie de mots sans aucun corps visible ou palpable. Ce n’est pas l’image hachée des vidéos qui y change grand-chose, même si nous pouvons ainsi mutuellement nous reconnaître et préserver un minimum d’altérité. Lorsque nous parlons par téléphone, SMS, mails, nous sommes aussi invisibles que le virus lui-même. Nous ne sommes pas vraiment là. Ou plutôt nous ne savons pas si l’autre est vraiment là. Les masques, en nous identifiant aux « new normals », nous protègent du virus mais assimilent notre forme d’existence à la sienne : vivre caché et partout à la fois. Accélération du monde : nous sommes aliénés aux objets techniques. Décélération brutale et non souhaitée: nous n’acceptons pas de rompre, nous menacent le burnout et le ressentiment.
Notre corps devient un paradoxe: possiblement infecté, il nous fait penser à la mort tandis qu’il est vivant, la mort qu’il peut porter et la vie qui le porte. Nous pensons tous d’abord à nous protéger, ceux qui pensent d’abord à eux comme ceux qui pensent d’abord aux autres. Le monde se divise et nos corps nous séparent. En fait de rupture, nous devons nous préparer à une authentique fracture opposant plus tragiquement : les riches / les pauvres, les travailleurs / les précaires, les éclairés / les incultes, les révoltés / les soumis, les autonomes / les dépendants, les vieux / les jeunes. Chacun dans le confinement se replie autour de sa norme intérieure et découvre sa temporalité propre, sans qu’elle ne puisse plus s’accorder à celle des autres. Le monde est comme réduit à l’échelle d’un homme seul, que ne sécurisent plus les frontières et les normes, même quand elles se durcissent. Les managers, les chefs d’entreprise, doivent apprendre à percevoir ce que peuvent souhaiter les individus isolés dans un tel monde. La norme ou la vie ? C’est un choix impossible que seule une société fasciste nous a dans l’histoire malheureusement déjà imposé.
Prévoir l’effondrement du monde : si nous voulons éviter que ce ne soit pour tout de suite la fin, il faut pouvoir se détacher du monde. Ne le bâtissons pas comme une forteresse, renonçons à la violence des catégories, ne validons pas l’alliance de la science et du positivisme, privilégions la fantaisie, sortons des sentiers battus, ouvrons les portes de la perception, attendons-nous comme Edgar Morin à l’inattendu, quittons comme le préconisait Husserl nos vêtements d’idées pour faire voir notre place dans le monde vivant tel qu’il est, laissons apparaître à l’état naissant ses formes encore incertaines et colorées. Méfions-nous des catégories toutes faites du vivant. Aimons le vivant pour lui-même, non pour la théorie que l’on en fait. La science normale (l’expression est de Kuhn) n’a jamais rien découvert. Elle ne sert qu’à confirmer ce que déjà l’on croit savoir. Elle ne préserve aucun mystère et recouvre aussitôt tout ce qu‘elle contribue à découvrir. Si nous parlons de reprise pensons à son sens existentiel. Ne recommençons pas les mêmes choses. Laissons être le nouveau. N’espérons pas une reprise économique, qui viendra peut-être et de surcroit, mais une reprise par elles-mêmes du pouvoir propre des personnes.
Espérons tout autant une reprise de la nature par elle-même. Qu’elle nous aide à accomplir notre progression. La pandémie, ce virus qui franchit allègrement les normes et les frontières, ni être vivant, ni chose, issu de la nature (quoiqu’en pensent les complotistes), a été perçu par certains comme sa vengeance même. La nature malmenée par les hommes tente de les exterminer, comme les hommes l’ont presque déjà fait des pangolins et des chauvesouris. Ce sont les vieux qui sont morts seuls et ceux qui étaient seuls sont morts les tous premiers. La nature est injuste, tout comme l’était Dieu lui-même lorsqu’il frappait Job. La nature, esprit vengeur, nous a mis face à notre incapacité morale à préserver les plus fragiles, accompagner et protéger les vieux, laisser les délirants tranquilles, laisser le bipolaire qui est en chacun de nous avoir des émotions et des humeurs, laisser les timides et les solitaires préférer le confinement aux mauvaises rencontres. Politiques, managers, économistes, médecins, psychologues, que l’entreprise puisse avoir un pouvoir négatif sur l’humeur nous avait alertés. Mais nous lui avons opposé des normes et des principes là où il fallait privilégier la vie, la diversité, la santé comme globalité.