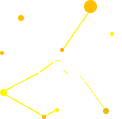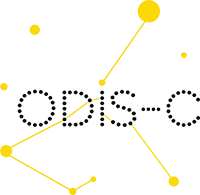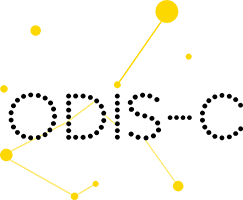2025 a été proclamée “grande cause nationale pour la santé mentale”.
Une annonce ambitieuse, largement relayée, qui a immédiatement suscité de vives réactions : beaucoup de professionnels y ont vu un paradoxe. Comment célébrer une grande cause quand la psychiatrie traverse l’une des pires crises de moyens depuis trente ans ?
Ce contraste, presque ironique, dit beaucoup de la situation actuelle : les besoins en santé mentale ne cessent de croître dans les secteurs sanitaire, médico-social et social, tandis que les équipes, elles, s’amenuisent. Les établissements sont confrontés à des situations toujours plus complexes, où se mêlent enjeux psychiques, tensions institutionnelles, vulnérabilités sociales, ruptures répétées et crises difficultés à endiguer.
Dans cette réalité concrète – loin des slogans et des communiqués – les équipes mobiles en santé mentale sont devenues un outil essentiel. Non parce qu’elles auraient été mises à l’agenda politique, mais parce qu’elles répondent précisément à ce que vivent les personnes, les familles et les professionnels.
Une équipe mobile, concrètement, qu’est-ce que c’est ?
Il n’existe pas de définition simple ou univoque d’une équipe mobile. Le terme recouvre une variété de dispositifs qui se sont développés différemment selon les territoires, les besoins, les ressources disponibles et les dynamiques institutionnelles. On peut toutefois repérer des standards communs, que nous développons dans un article dédié : la mobilité, la pluridisciplinarité, la capacité à intervenir rapidement, et l’ancrage dans le milieu de vie.
Une équipe mobile, c’est avant tout une manière d’aller là où la situation se joue réellement.
Les interventions se déroulent à domicile, dans un établissement médico-social, dans un service social, dans la rue, dans un EHPAD ou dans n’importe quel lieu où l’enjeu relationnel, contextuel ou organisationnel se manifeste.
Cette approche « hors les murs » permet d’observer ce que les lieux institutionnels ne donnent pas toujours à voir : les tensions quotidiennes, les interactions qui figent, les habitudes qui renforcent les blocages, les contraintes matérielles, les attentes des proches, les temporalités de chacun.
Et surtout, l’équipe mobile ne se limite jamais à une lecture clinique. Elle travaille sur la situation dans son ensemble — ce qui se joue entre les personnes, entre les professionnels, entre les institutions. C’est une pratique résolument systémique, qui considère qu’une crise n’est pas seulement un symptôme, mais un moment où un système cherche une autre manière de fonctionner.
À qui s’adressent les équipes mobiles ?
Les équipes mobiles interviennent auprès des personnes en souffrance psychique, bien sûr, mais aussi auprès des proches, et surtout auprès des professionnels déjà engagés dans l’accompagnement.
Les familles peuvent être épuisées ou prises dans la confusion ; les équipes de terrain peuvent se sentir seules, dépassées ou en désaccord sur la conduite à tenir. Les établissements peuvent se retrouver face à des situations qui se répètent, s’enveniment ou échappent à leurs dispositifs habituels.
L’intervention mobile vise d’abord à éviter les ruptures : rupture de soins, rupture familiale, rupture institutionnelle. Mais elle va plus loin. Elle cherche à favoriser l’accès aux soins, à ouvrir des portes, à créer des alliances, à rendre possible ce qui ne l’était plus.
Elle repose sur une conviction qui traverse toutes les approches systémiques :
dans une même situation, plusieurs solutions sont toujours possibles.
Il s’agit de trouver, avec les acteurs, celles qui sont les plus ajustées, les plus soutenables et les plus dignes.
Quel est leur rôle aujourd’hui ?
Les équipes mobiles jouent plusieurs rôles, qui s’entremêlent selon les situations.
Elles interviennent en résolution de crise, lorsque la tension est trop forte, que les acteurs sont au bord de la rupture ou que les solutions institutionnelles classiques ne suffisent plus.
Elles permettent alors de ralentir, de comprendre, de décaler le regard, de redonner de l’espace.
Elles offrent une alternative précieuse à l’hospitalisation, à un moment où celle-ci est parfois utilisée faute d’autres possibilités.
Elles soutiennent les professionnels en place, non pas en se substituant à eux, mais en agissant comme un tiers.
Ce rôle de tiers est souvent décisif : il permet de remettre du mouvement là où tout semblait figé, de créer des points d’accord, de reformuler les enjeux, de clarifier les places.
Elles jouent également un rôle majeur dans la coordination.
Une situation complexe implique rarement un acteur unique : hôpital, secteur social, médico-social, famille, école, justice… Souvent, chacun agit dans la meilleure intention, mais selon une logique différente.
L’équipe mobile permet alors de reconnecter ces mondes, de fluidifier la communication, de chercher une cohérence commune.
Enfin, elles contribuent à réduire le recours aux mesures coercitives, en proposant des solutions alternatives, plus ajustées, plus humaines et souvent plus efficaces.
Un travail essentiel, dans un contexte où la lutte contre la coercition devient un enjeu éthique, clinique et politique majeur.
Pourquoi sont-elles devenues indispensables ?
Les équipes mobiles sont aujourd’hui au cœur des transformations de la santé mentale.
Elles se développent pour plusieurs raisons simultanées.
D’abord parce que les besoins augmentent. Les établissements voient arriver des situations plus complexes, plus imbriquées, parfois plus urgentes.
Ensuite parce que les moyens diminuent. Les équipes hospitalières et médico-sociales sont sous pression, les files d’attente s’allongent, les ruptures se multiplient, les professionnels s’épuisent.
Mais surtout parce que les équipes mobiles incarnent une manière flexible, contextualisée et réactive d’intervenir, capable de s’ajuster aux territoires, aux cultures professionnelles, aux contraintes institutionnelles et aux réalités sociales.
Elles ne sont pas un protocole : elles sont une manière de faire, d’être, de penser les situations différemment.
Elles représentent aussi une réponse sérieuse à la crise de la psychiatrie : en réintroduisant du mouvement, du lien, de la présence, des alternatives, elles montrent qu’un autre mode d’intervention est possible.
Quelles sont les bonnes pratiques d’intervention ?
Les équipes mobiles les plus efficaces sont celles qui parviennent à lire finement la situation dans son ensemble. Elles observent les interactions plutôt que les individus isolés, les contextes plutôt que les comportements, les dynamiques plutôt que les symptômes.
Elles savent ajuster leur tempo : ni trop rapide — au risque de déstabiliser — ni trop lent — au risque de laisser la situation s’enkyster.
Elles travaillent avec les acteurs, pas sans eux, et encore moins à leur place.
Elles cherchent les petits changements possibles, les micro-leviers qui peuvent modifier la dynamique globale.
Elles valorisent les forces présentes, même lorsque tout semble bloqué.
Et surtout, elles gardent une posture de curiosité, d’alliance et de respect, indispensable pour éviter les erreurs d’interprétation, les décisions précipitées et les escalades inutiles.
Pourquoi former les équipes mobiles ?
Créer une équipe mobile ne consiste pas à déployer un dispositif “clé en main”.
Chaque équipe doit trouver sa manière d’intervenir, en fonction de son territoire, de ses partenaires, de son histoire institutionnelle, de sa culture professionnelle.
La formation permet d’acquérir une lecture systémique des situations, une posture de tiers, une façon de travailler en binôme, une culture du moindre recours, une intelligence de réseau et une capacité d’intervention en crise.
Elle permet aussi de renforcer l’identité collective de l’équipe, de stabiliser son mode de fonctionnement et de construire une cohérence interne.
Une équipe mobile efficace est une équipe pensée, formée, accompagnée et ajustée à son contexte réel.
Les équipes mobiles en santé mentale ne sont pas une innovation opportuniste.
Elles sont la réponse la plus ajustée aux besoins actuels : aller-vers, intervenir rapidement, soutenir les professionnels, proposer des alternatives à l’hospitalisation, réduire la coercition, coordonner les acteurs et redonner du sens à des situations souvent prises dans la confusion.
Dans un système fragilisé, elles représentent une manière d’agir plus humaine, plus contextualisée et plus efficace.
Elles ne sont pas seulement un outil : elles sont une manière de transformer les pratiques.
Vous souhaitez développer des équipes mobiles ?